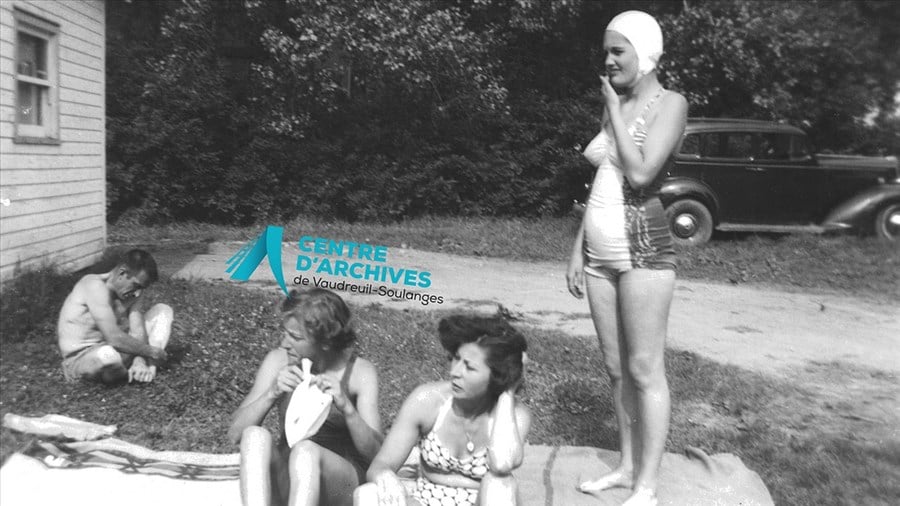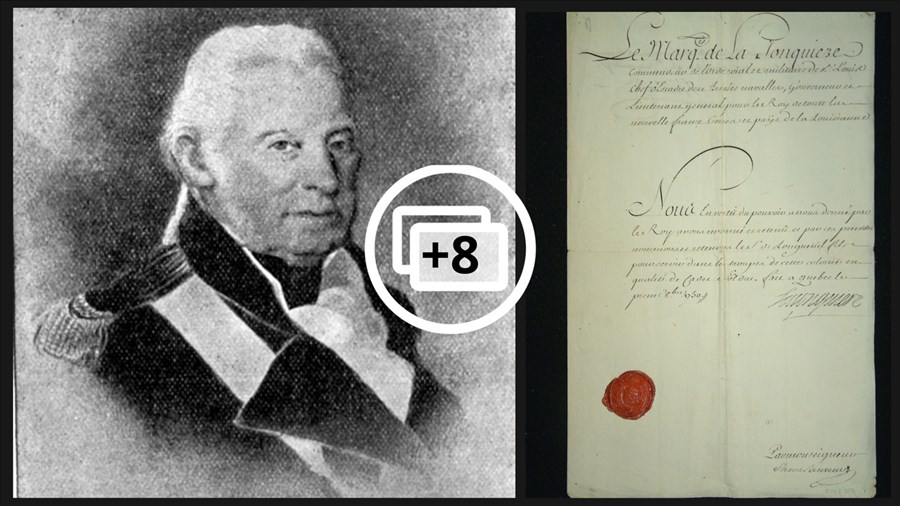Michaël Dicaire, archiviste, Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges.
Courte histoire de la cabane à sucre
Cabane à sucre de la famille Émond sur des Chenaux, Vaudreuil ©
Ancienne goudrelles en bois
Le temps des sucres, famille Laframboise
Personnes identifiées : 1- Hortense Boileau, 2- Bernard Lalonde, 3-Jean Louis Boileau, notaire, 4- Rolande Legault (Rigaud)
Au sucre chez Servant, Diane Guertin, amie d’Eustache Boileau (Rigaud)
Avril 1976 à la cabane à sucre chez Germain Faubert. Germain transporte un seau d’eau d’érable. Chevaux de gauche à droite : Mignonne et sa fille princesse (Rigaud)
Par Centre d'Archives de Vaudreuil-Soulanges
Le temps des sucres est un moment depuis longtemps ancré dans les traditions québécoises. Il fait partie de notre patrimoine immatériel et est devenu un symbole de notre identité commune.
Le sirop d’érable, la tire, la soupe aux pois, les grands-pères dans le sirop, les fèves au lard font partie de l’ADN québécois. Dans cet article, nous allons explorer l’histoire de la cabane à sucre ce qui nous mènera à comprendre pourquoi et comment cet emblème est devenu une marque indélébile de notre culture.
Chez les Autochtones
La récolte de la sève d’érable se faisait déjà depuis très longtemps chez les Autochtones avant l’arrivée des Européens. Plusieurs légendes tournent autour de la découverte de la sève d’érable. L’une d’elles est celle d’un garçon parti à la chasse à la perdrix. Ce dernier, en voulant atteindre une perdrix, aurait percé un érable. La sève coula et le garçon y goûta. Il ramena un carquois rempli de cette eau sucrée à son campement.
Les Autochtones faisaient de larges entailles avec des outils comme le tomahawk et ils récoltaient la sève à l’aide de cornets d’écorce. Rendue au campement, la sève était chauffée grâce à des pierres chaudes. En l’absence de contenant métallique, les autochtones n’avaient pas maîtrisé l’art de transformer la sève en sirop.
Leur méthode de cuisson, bien qu’elle faisait épaissir la sève quelque peu, n’amenait pas la sève à une température assez haute. On raconte que l’on faisait également cuire des ingrédients comme le blé d’Inde, la viande et autres légumes dans la sève pour lui donner un goût sucré. Les autochtones voyaient dans l’eau sucrée des propriétés médicinales. On s’en servait comme remède et pour redonner de l’énergie.
Le plus vieux texte européen concernant cette pratique provient d’un dénommé Thevet (explorateur et écrivain-géographe français) en 1558, qui dit, et je cite : ‘’il en saillit un suc, lequel fut trouvé d’autant bon goust et délicat qu’un bon vin d’Orléans ou de Beaune’’.
Les tout débuts de l’acériculture en Nouvelle-France
Au tout début de la colonisation, les colons français utilisent des techniques très rudimentaires. On fait d’énormes entailles de six pouces (15 cm) dans les érables à coups de hache pour récolter la sève. À partir de 1672, il est enregistré que les sucriers de Cap-Breton utilisent dorénavant un vilebrequin ou un foiret pour faire la récolte. L’eau coule par un petit bout de bois introduit dans l’arbre (ancêtre de la goudrelle). En 1708, les mêmes techniques sont rapportées à Port-Royal, en Acadie. Les techniques de récolte s’améliorent donc définitivement. En revanche, au cœur de la Nouvelle-France, les méthodes prennent du temps à arriver. Les coupes à la hache ou au couteau dureront plus longtemps qu’en périphérie du territoire français.
Dans les débuts de l’exploitation de l’érable, les usages de l’eau d’érable varient. On rapporte même la concoction d’eau-de-vie aromatisée. On mélangeait l’eau-de-vie avec la sève d’érable, des clous de girofle et de la cannelle. Il est question de sucre d’érable à partir de 1691. À cette époque, les exportations vers la France de petits pains de sucre d’érable ont débuté. Ce sucre est alors utilisé comme remplacement du sucre traditionnel lorsque ce dernier n’est pas disponible.
L’industrie prend de l’ampleur et s’améliore
Au début du 18e siècle, l’industrie de l’érable est en forte augmentation, surtout dans la région de Montréal et de Trois-Rivières. On estime qu’environ 30 000 livres de sucre étaient produites sur l’île de Montréal. Cette popularité du commerce force les autorités à procéder à sa législation pour empêcher les abus de toutes sortes. Par exemple, des zones sont identifiées comme interdites à l’exploitation acéricole. Des interdictions sont également mises en place à certains endroits sur la manière de procéder à la récolte. Ainsi, on interdit la récolte à la hache qui endommage trop les arbres. À Bellechasse, cette interdiction est contrecarrée avec une nouvelle technique, les entailles se limitent maintenant à 1 pouce (2,5 cm).
Pour ce qui est des outils, jusqu’au 20e siècle, les chalumeaux d’éclisse, des auges de bois taillées à l’herminette et les chaudrons de fer dominent. La goudrelle évolue cependant : taillée dans une pièce de bois puis façonnée dans un bout de branche de genévrier percé à l’aide d’une broche rougie au feu. Ce n’est qu’au 20e siècle qu’on voit vraiment apparaître les accessoires métalliques. Des casseaux d’écorce, on passe aux seaux en tôle puis en aluminium. Les goudrelles en bois sont remplacées par des goudrelles ou des chalumeaux en métal roulé.
Pour ce qui est de la méthode de cuisson, elle a rapidement évolué au fil du temps. Au tout début, les colons qui, au contraire des Autochtones, avaient accès à la métallurgie faisaient cuire la sève dans un chaudron, sur un feu ouvert. Étant donné que le feu était exposé aux éléments, la température n’atteignait tout de même pas un degré assez haut pour en arriver à du sirop. C’est à partir du 18e siècle que l’on cuit la sève sur un feu couvert, généralement dans des chaudrons de fer suspendus à un arbre. Ainsi, les colons français se sont mis à maîtriser la technique de fabrication du sirop d’érable que l’on connaît aujourd’hui. C’est aussi à ce moment que l’on découvre la tire. On faisait bouillir la sève jusqu’à ce qu’elle atteigne une certaine concentration et on la versait sur la neige. Nos ancêtres ont donc pu, dès le 18e siècle, se régaler de tire sur neige comme nous le faisons aujourd’hui.
Le transport de l’eau d’érable évolue aussi avec le temps. Autrefois, l’acériculteur transportait l’eau à l’aide de chaudières. Vint ensuite l’introduction du bœuf et puis du cheval pour faciliter la tâche. L’eau est transvidée dans un tonneau installé sur une traîne.
D’abri rudimentaire à cabane moderne, l’évolution de la cabane à sucre
Les premières cabanes à sucre sont de simples abris de planches ou d’écorce sous lesquels sont entreposés les chaudrons. Elles sont construites au printemps et démontées à la fin de la saison des sucres. Les habitants font un trou dans la neige jusqu’au sol sur une superficie d’environ 20 pieds (environ 6 mètres). Ils construisent une cabane de bois rond dont le milieu du toit est à aire ouverte pour laisser passer la fumée. C’est ainsi un emprunt au campement nomade des autochtones. La cabane telle qu’on connaît aujourd’hui n’apparaît pas avant la deuxième moitié du 19e siècle.
Les abris rudimentaires créés pour la fabrication de sirop deviennent, vers la fin 19e siècle, des cabanes permanentes pouvant accueillir les gens. L’introduction de l’évaporateur vient modifier la donne. Ceci révolutionne le monde de l’acériculture et améliore grandement la méthode de production. Les installations se modifient pour accueillir cet équipement, les cabanes deviennent permanentes. L’eau d’érable est recueillie, puis filtrée et bouillie pendant plusieurs heures dans l’évaporateur avant de se transformer en sirop. Sa couleur, soit dorée clair au très foncé, dépend simplement du moment de la récolte.
Le modèle architectural des cabanes se standardise, un espace dédié au bouillage possédant un trou au toit pour laisser échapper la vapeur, un endroit pour entreposer l’eau d’érable et les outils, une pièce pour cuisiner et dormir, un abri pour le bois et une écurie pour le cheval sont aménagés. Les cabanes sont généralement construites sur une petite colline, idéalement au milieu de l’érablière dans un endroit sec et le plus ensoleillé possible.
Au fil du temps, les cabanes sont devenues plus sophistiquées. Elles sont équipées de chaudrons, de poêles, de cheminées et de tuyaux pour collecter la sève. Tout cela, combiné avec l’amélioration des techniques et des meilleurs outils, a fait en sorte que la production de sirop d’érable s’est vue grandement améliorée. Les quantités sont devenues de plus en plus importantes.
Au début de l’histoire des cabanes à sucre, les convives apportaient leur propre nourriture et le cuisinier l’apprêtait à sa manière tout en ajoutant bien sûr de généreux filets de sirop d’érable. C’est plus tard que les cabanes à sucre commencent à faire leurs propres plats.
Au 20e siècle, elles gagnent profondément en confort. Elles deviennent souvent une résidence secondaire pour l’acériculteur. Pendant le temps des sucres, la famille de l’acériculteur s’y réunit pour des fêtes gourmandes et musicales. C’est l’avènement de la cabane à sucre familiale.
Périodes de crise
Comme toute entreprise/métier, l’acériculture est affectée par des périodes de crise notamment au début du 20e siècle. Rien ne va plus et plusieurs acériculteurs décident même de faire couper leur érablière pour avoir au moins l’argent du bois. Le gouvernement est sommé d’agir et crée des sucreries-écoles pour tenter d’améliorer les méthodes de production. Dès 1914, le ministère de l’Agriculture a créé plusieurs sucreries-écoles. Ces écoles offrent des cours de perfectionnement et des conseils sur les méthodes de production moderne. Les écoles développent également de nouveaux produits de l’érable. Dans la foulée de cette crise, en 1920, est créée la première coopérative pour gérer collectivement l’offre et la demande et développer de nouveaux produits.
Les années 1970 à aujourd’hui
Ce n’est que dans les années 1970 que la production de sirop d’érable se transforme en véritable industrie à grande échelle et que les cabanes à sucre commerciales se multiplient par centaines. À ce moment, la technologie progresse encore plus rapidement. L’industrie est de plus en plus structurée et la recherche constante d’un meilleur rendement vient modifier le portrait socioéconomique de l’acériculture. Beaucoup adoptent l’automatisation pour certaines de leurs opérations, tandis que les petites entreprises familiales font perdurer les méthodes traditionnelles et ancestrales.
Malgré l’avancement de la technologie, la production encore plus efficace et la modification du portrait socioéconomique de cette industrie, il n’en demeure pas moins qu’une part importante de ce secteur demeure entre les mains de petites et moyennes entreprises familiales. Celles-ci font perdurer le savoir-faire ancestral de génération en génération. Une part importante du marché provient donc toujours de l’artisanal plutôt que du commercial.
La cabane à sucre, c’est avant tout un endroit pour célébrer en famille et entre amis. C’est le retour du printemps, un moment de festivité. C’est un décor rustique, des tables avec des nappes à carreaux, des feux de bois, de la musique traditionnelle québécoise et une séance de gigue. Le temps des sucres est un court moment dans l’année, généralement de la mi-mars à la fin du mois d’avril. C’est l’occasion de se réunir pour célébrer un rite saisonnier caractéristique du Québec.
Aujourd’hui, on estime qu’il y aurait environ 20 000 cabanes à sucre sur le territoire québécois. Les Québécois consomment en moyenne 3,2 litres de sirop d’érable annuellement et le Québec demeure, encore aujourd’hui, le plus grand producteur de sirop d’érable au monde avec environ 71% de la part du marché mondial selon terroir et saveurs du Québec. Le Québec domine donc depuis toujours cette industrie fort unique.
Signe que l’acériculture est venue imprégner l’identité nationale canadienne, dans les années 1990, le ministre de la Défense du Canada, Marcel Masse, fait remplacer le sirop de poteau par du vrai sirop d’érable dans toutes les cafétérias des bases militaires. Décision fortement appréciée par les acériculteurs et bien sûr, des militaires. L’érable est devenu avec le temps l’ultime symbole du Canada.
Conclusion
Au fil du temps, la population s’est fortement approprié cette période qu’est le temps des sucres. Il est devenu synonyme de fierté nationale non seulement au Québec, mais à travers le Canada. La production de sirop d’érable est maintenant fortement associée au Québec et au Canada. Le temps des sucres et toutes ses traditions occupent une place fort importante dans l’imaginaire collectif, c’est maintenant un symbole identitaire. Il n’en tient qu’à nous de perpétuer ce riche héritage ancestral qui contribue à faire de nous un peuple unique au monde.
Auteur : Michaël Dicaire, archiviste, Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges.